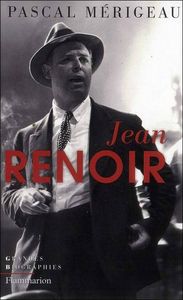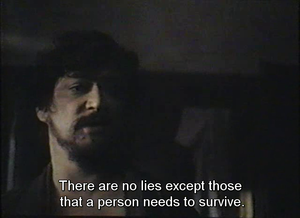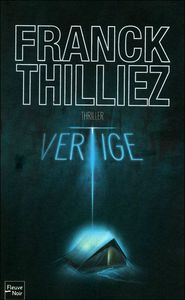Si vous avez envie d'ouïr de petits airs de flutiau, de voir gentes dames d'un baiser jouir et manants devant chevaliers fuir, ce film est pour vous. Si en plus vous êtes prêt à passer quatre-vingt-dix minutes avec un héros moulé dans de gros collants Phildar, vous risquez de ne pas être déçu du voyage. Par contre, si vous êtes adeptes de kung-fu ou de Bruce Willis, oui, là, il vaudra sans doute mieux passer votre chemin... On connaît l'étrange attirance du gars Huston pour la thématique de la mort (les premières minutes d'Under the Volcano suffisent à le démontrer sans même qu'on ait besoin de parler de... The Dead) et il est clair que cette période moyenâgeuse en pleine guerre de Cent Ans se révèle particulièrement propice aux variations morbides : cadavres d'animaux jonchant les plaines, pauvre quidam égorgé par des soldats un brin violents, paysans attaquant à la fourche et au burin les châteaux et leurs occupants, chevaliers transperçant d'un coup de lance ces salopiots de paysan - ou en démembrant un quand il se montre particulièrement têtu -, religieux et assimilés aimant le fouet et les actes de contrition ("Pour devenir pur avant d'accéder à la Terre Sainte, il vous faut remplir une condition - Ok, vas-y, balance - Vous devez vous coupez les parties - Je n'accepte pas la condition")... Bref, l'image a beau baigner dans un halo de lumière (on se croirait presque dans Bilitis...), les violons de Delerue ne se charger de teintes que très légèrement dramatiques, le héros frais émoulu de l'universitéêtre gentil comme une châtaigne et l'héroïne (Anjelica Huston, 18 ans et fraîche comme un coeur) être belle comme les blés, l'ambiance n'est po vraiment à la rigolade. Au delà de nos deux amants qui traversent ce monde ravagé et sanguinaire comme une étoile filante dans un ciel nuageux (cela me rappelle le nom d'un temple à Pékin... passons), peu d'échappatoire dans cette oeuvre où les hommes de religion, les aristos ou les culs-terreux passent leur temps à se déchiqueter entre eux. Les temps sont durs : un cheval que tu laisses bêtement sur un chemin ayant autant de chance de se faire voler - ou dépecer - qu'une mob que tu laisses en pleine rue dans le 9-3. On n'arrête pas de se plaindre de nos jours mais les sombres individus de l'époque semblaient aussi hilarants et porteurs d'espoir que le front de Jean-François Copé... Des temps sombres qui sont tout juste éclairés par nos deux amants, des amants dont l'amour n'a de cesse de flirter avec la mort, jusqu'au bout... Le héros rêvait de voir la mer, il trouvera l'infini de l'amour... à en mourir. Eh be.
C'est un peu cucul, dit comme cela, mais franchement, avouons qu'on n'est pas non plus dans les summums de la carrière du grand John... On assiste certes à un joli effort au niveau de l'ambition du projet - des films moyenâgeux dignes de ce nom se comptent sur les doigts des deux mains, sur les doigts d'une main si on enlève ceux de Rohmer... -, et au niveau de la reconstitution (costumes, décors...) mais il demeure quand même un peu ardu de se passionner pleinement pour la passion de nos deux héros un peu niaiseux. J'avoue aussi, pour être sincère jusqu'au bout, que je m'attendais à pire (sur Shangols on est un peu maso, ce n'est pas nouveau) au niveau chienlit. Oui, non, ça passe, même si on sent bien parfois l'influence un peu limite du flower power (69, cela ne s'invente pas) : nos deux héros nus dans l'herbe, puis folâtrant dans les champs comme deux gamins chahutant sur des lits en plume... Mouais. Allez, on reste dans le collector et cette petite pièce hustonienne marquera sans nul doute des points lors d'une éventuelle odyssée.